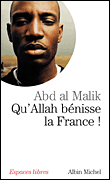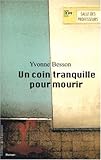Si l’été est propice aux romans policiers, je me suis inscrit dans la vague et ai lu quelques polars bretons ayant pour cadre la Bretagne, plus précisément la côte d’Émeraude, dont je me fais l’écho ici.
 En premier lieu, j’ai eu le plaisir d’acheter le livre Saint Michel, Priez pour eux de Jean-Pierre Alaux. Fin des années 70, Séraphin Cantarel, conservateur au Ministère de la Culture, est envoyé en mission pour préparer le dossier de l’UNESCO d’ajout du Mont Saint-Michel au patrimoine de l’humanité et procéder aux restaurations nécessaires : la flèche et l’archange notamment. Avec son jeune assistant Trelissac, il doit mener à bien cette opération. Mais les ennuis s’amoncellent. L’Amoco Cadiz, énorme pétrolier, vient de faire naufrage. Notre héros craint que sa cargaison vienne souiller la baie. A cela s’ajoute le cadavre revêtu d’une bure semblable aux occupants de l’abbaye. Voilà qui fait du plus mauvais effet ! La presse locale s’empare de l’affaire. Notre héros, aidé de son assistant, réalise à la fois la restauration et l’enquête.
En premier lieu, j’ai eu le plaisir d’acheter le livre Saint Michel, Priez pour eux de Jean-Pierre Alaux. Fin des années 70, Séraphin Cantarel, conservateur au Ministère de la Culture, est envoyé en mission pour préparer le dossier de l’UNESCO d’ajout du Mont Saint-Michel au patrimoine de l’humanité et procéder aux restaurations nécessaires : la flèche et l’archange notamment. Avec son jeune assistant Trelissac, il doit mener à bien cette opération. Mais les ennuis s’amoncellent. L’Amoco Cadiz, énorme pétrolier, vient de faire naufrage. Notre héros craint que sa cargaison vienne souiller la baie. A cela s’ajoute le cadavre revêtu d’une bure semblable aux occupants de l’abbaye. Voilà qui fait du plus mauvais effet ! La presse locale s’empare de l’affaire. Notre héros, aidé de son assistant, réalise à la fois la restauration et l’enquête.
Par un jeu de dialogues savamment construit, l’auteur invite le lecteur a plongé dans l’histoire du Mont-Saint Michel, merveille du monde chrétien occidental. C’est cette Histoire mise en second plan et distillée brillamment dans l’intrigue romanesque qui m’a passionnée. Les péripéties s’enchaînent rapidement ce qui donne à ce roman – à mon sens – le qualificatif de polar historique. N’étant pas un fan des romans policiers ou des polars, j’ai trouvé que la mise en place du décor n’était pas trop longue et que le lecteur rentre vite dans l’enquête, idéal en ce qui me concerne. J’ai plongé dans le Mont grâce à Séraphin (un ange ![]() ) et j’ai parcouru ce livre à la vitesse d’un cheval au galop. Sa lecture m’a fait penser – pour le style – à la série de roman Le Saint de X dans le rythme et l’intrique. Dans tous les cas, je me suis régalé !
) et j’ai parcouru ce livre à la vitesse d’un cheval au galop. Sa lecture m’a fait penser – pour le style – à la série de roman Le Saint de X dans le rythme et l’intrique. Dans tous les cas, je me suis régalé !
40 kilomètres plus loin, vers l’ouest (rien de nouveau), moins à vol d’oiseau, rien ne va plus à Cancale. En moins de trois semaines, deux personnes décèdent après avoir mangé des huîtres empoisonnées, une troisième en réchappe de peu. Dans la perle noire de Cancale, Anne Chambrin nous entraîne dans l’univers ostréicole cancalais. Elle nous fait découvrir l’ambiance de cette ville côtière vivant au gré des marrées. Cancale dépend des huîtres et des touristes qui les attirent. Il faut trouver rapidement l’origine de ce fléau. Estelle Y, policière à Saint-Malo y est dépêchée pour résoudre ce mystère aqueux.
personnes décèdent après avoir mangé des huîtres empoisonnées, une troisième en réchappe de peu. Dans la perle noire de Cancale, Anne Chambrin nous entraîne dans l’univers ostréicole cancalais. Elle nous fait découvrir l’ambiance de cette ville côtière vivant au gré des marrées. Cancale dépend des huîtres et des touristes qui les attirent. Il faut trouver rapidement l’origine de ce fléau. Estelle Y, policière à Saint-Malo y est dépêchée pour résoudre ce mystère aqueux.
Dynamique et pétaradante, l’auteure par les yeux de son héroïne nous dépeint une série de personnages, symboles du microcosme de cette ville et de l’atmosphère qui y règne. Par cette galerie, les lecteurs ayant parcouru le port de la Houle, la pointe du Grouin et la plage du Verger se transposeront sans aucune difficulté dans la cité ostréicole. Ils y sentiront l’iode s’exhumant des pages et le goût de l’huître fraîchement sortie de la mer. Personnellement, comme écrit juste avant, j’ai bien ressenti cette ambiance hivernale propre à la baie du Mont Saint-Michel.
Toutefois j’ai trouvé que le rythme était lent et que l’intrigue tirait trop en longueur se terminant par un dénouement brutal. En somme c’est un roman qui se lit pour l’ambiance et non son intrigue. Le roman aurait gagné à être plus court. Conclusion : oui pour l’ambiance et les paysages, non pour l’intrigue policière.
Cédric Beucher


 réfléchie que le système n’est pas le coupable. Il est un outil. Ceux qui le manient depuis une trentaine d’année le démontent sciemment pour produire un peuple où la critique est nulle. C’est un argumentaire dénonçant l’ensemble des mesures successives qui ont conduit l’école dans sa situation et surtout que c’est une démarche consciente et volontaire d’abrutissement de la population.
réfléchie que le système n’est pas le coupable. Il est un outil. Ceux qui le manient depuis une trentaine d’année le démontent sciemment pour produire un peuple où la critique est nulle. C’est un argumentaire dénonçant l’ensemble des mesures successives qui ont conduit l’école dans sa situation et surtout que c’est une démarche consciente et volontaire d’abrutissement de la population. François Mauriac, avec un style percutant, dépouille de manière acide les sentiments de ses protagonistes : l’avarice de Louis, son machiavélisme et celui de ses enfants, la religion (alibi obligé et garant d’une respectabilité). Il parle de « devoirs » et « d’obligations ». D’autres y verront un refuge face aux difficultés de la vie (abandon, décès, etc.). Le silence où l’amour est oublié au profit d’une vénalité. Ce silence où rien ne se dit : aucun sentiment ne se partage. Et pourtant l’amour se fraye un passage dans le cœur de Louis, ce nœud de vipères, vers un neveu et fils illégitime qui, il l’espère, rachètera la conduite de ses enfants.
François Mauriac, avec un style percutant, dépouille de manière acide les sentiments de ses protagonistes : l’avarice de Louis, son machiavélisme et celui de ses enfants, la religion (alibi obligé et garant d’une respectabilité). Il parle de « devoirs » et « d’obligations ». D’autres y verront un refuge face aux difficultés de la vie (abandon, décès, etc.). Le silence où l’amour est oublié au profit d’une vénalité. Ce silence où rien ne se dit : aucun sentiment ne se partage. Et pourtant l’amour se fraye un passage dans le cœur de Louis, ce nœud de vipères, vers un neveu et fils illégitime qui, il l’espère, rachètera la conduite de ses enfants.